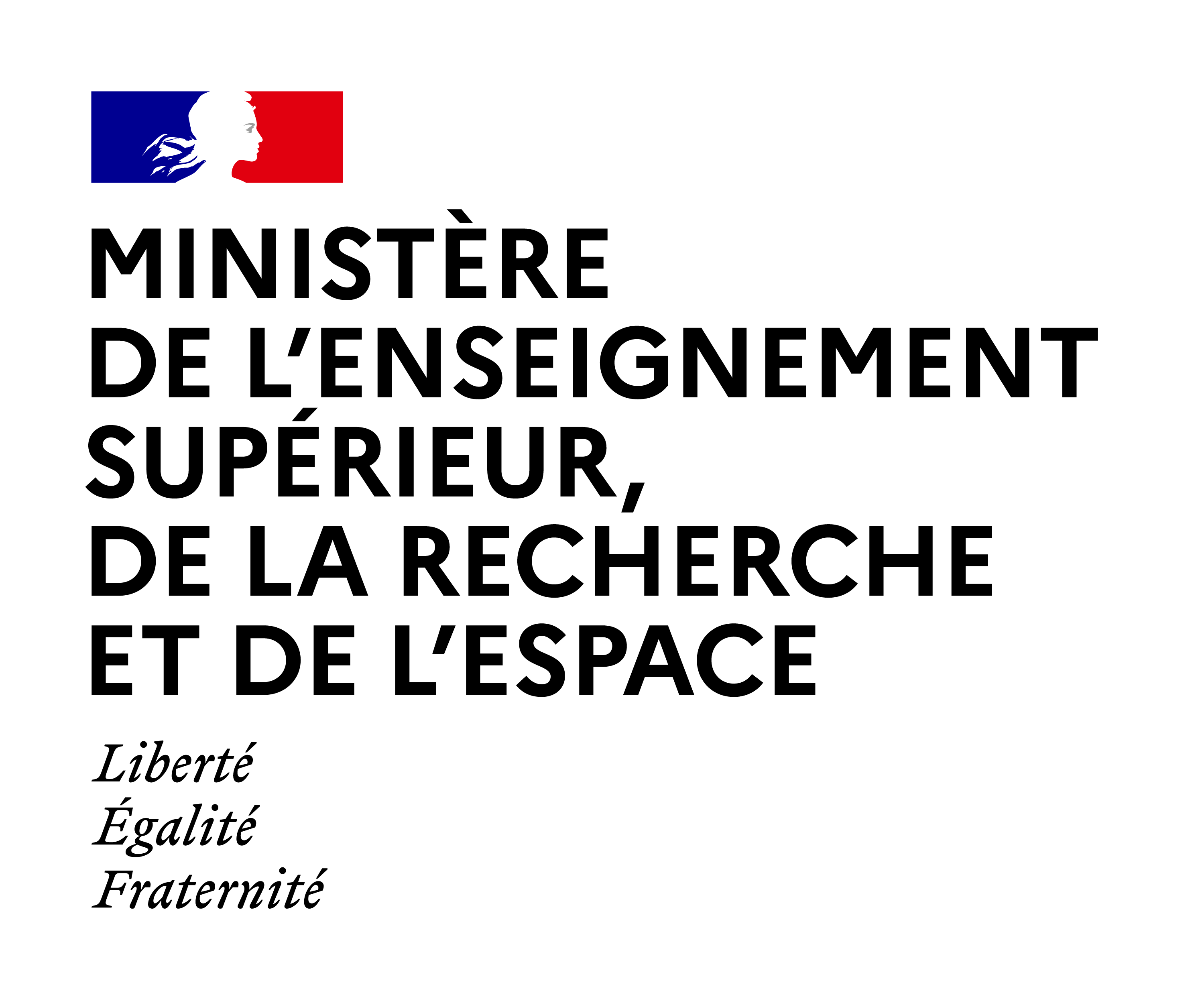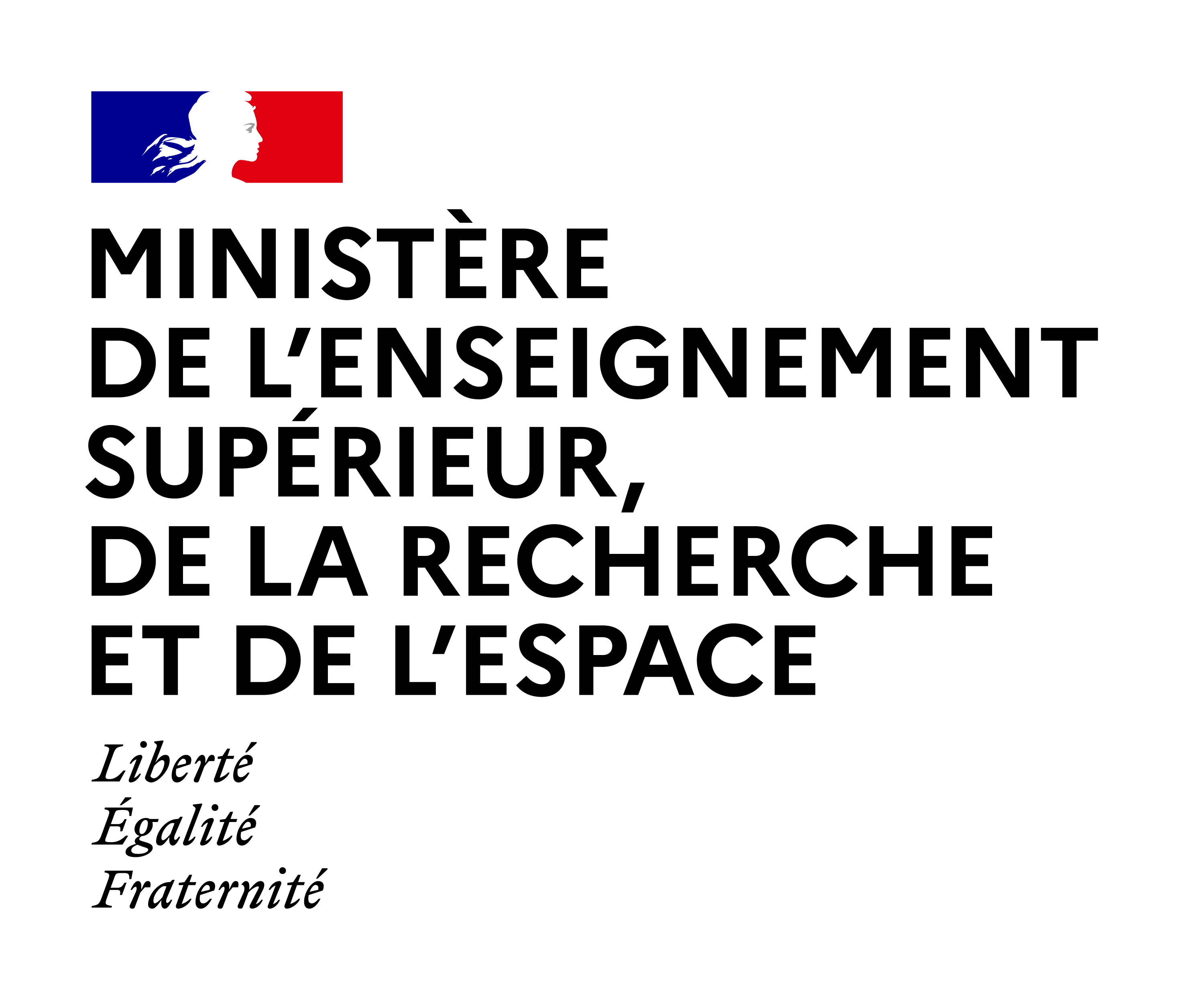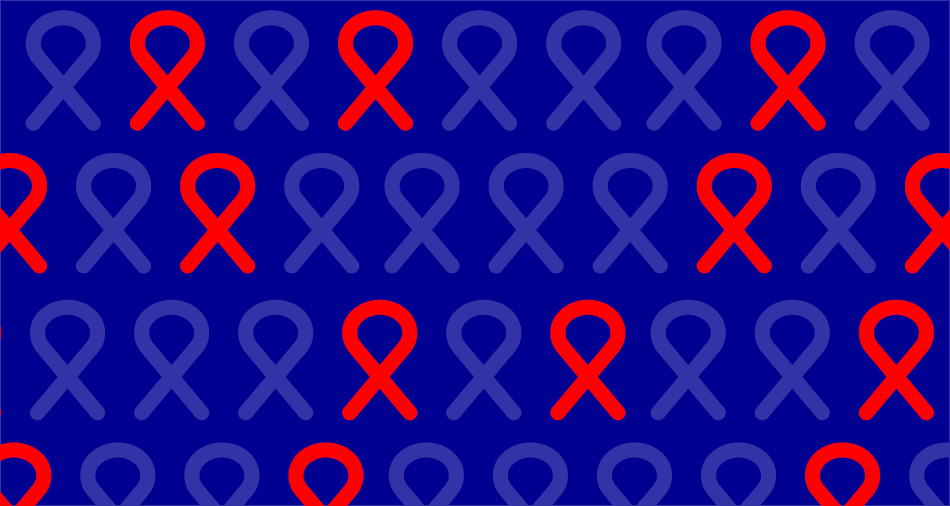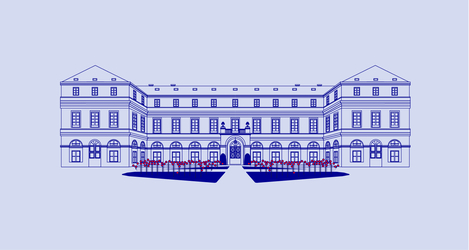La France à la pointe de la recherche contre le SIDA
- La France est le 2e pays européen en nombre de publications scientifiques produites dans le domaine VIH/SIDA (6e place mondiale).
- Dans le domaine du SIDA, la France tient, depuis le début de l’épidémie, un rôle de tout premier plan grâce notamment à l'action de l’ANRS, devenue ANRS | Maladies infectieuses émergentes, depuis sa fusion avec le consortium de l’Inserm REACTing le 1er janvier 2021.
L’ANRS | Maladies infectieuses émergentes est la nouvelle agence autonome de l’Inserm issue de la fusion entre l’ANRS et le consortium de l’Inserm REACTing. Créée en janvier 2021, c’est une réponse globale et ambitieuse à l’urgence de la lutte contre la pandémie de Covid-19 et à la préparation de la réponse aux futures épidémies. Elle a pour mission l’animation, l’évaluation, la coordination et le financement de la recherche sur le VIH/SIDA, les hépatites virales, les infections sexuellement transmissibles, la tuberculose et les maladies infectieuses émergentes et ré-émergentes.
Plus de 120 projets de recherche sur le VIH ont été soumis à l’ANRS et l’ANRS MIE ces deux dernières années, avec 49 projets retenus et soutenus par l’agence à hauteur de 60 millions d’euros.
Interview de Yazdan Yazdanpanah, directeur de l'ANRS
Des progrès scientifiques remarquables
La pandémie, qui s’est développée à partir de la fin des années 1970, a fait de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) un problème sanitaire mondial : le SIDA a tué plus de 35 millions de personnes et il tue toujours, en dépit des avancées médicales.
D'après une étude de Santé publique France, entre 2014 et 2023, les diagnostics de VIH chez les 15-24 ans serait en hausse de 41 %.
Les résultats des recherches menées au cours des dernières décennies tant dans le domaine fondamental, de la prévention et de la prise en charge des patients ont été remarquables.
- Découverte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) par les professeurs Françoise Barré-Sinoussi et Luc Montagnier en 1983 à l’Institut Pasteur, découverte récompensée par le Prix Nobel en 2008.
- Découverte des traitements anti-rétroviraux en 1996.
- En 2018, des chercheurs de l'Institut Pasteur et de l'Inserm ont percé le mystère des "patients contrôleurs", ces séropositifs qui parviennent à empêcher la réplication du virus sans le moindre médicament. Ils ont découvert que certaines de leurs cellules immunitaires ont la capacité de reconnaître des quantités infimes de virus. Leur système immunitaire est en fait beaucoup plus sensible que la moyenne, et tuent très rapidement les cellules infectées par le virus.
Des traitements et une prise en charge constamment améliorés
La recherche vaccinale, une priorité absolue
La France est l’un des principaux acteurs internationaux de la recherche d’un vaccin préventif contre le SIDA.
L’Institut de recherche vaccinale (VRI), labellisé "laboratoire d'excellence" par l’État français, a été établi par l’ANRS, l’Inserm et par l'Université Paris-Est Créteil (UPEC) afin de conduire des recherches visant à accélérer le développement de vaccins efficaces contre le VIH/SIDA.
Les résultats encourageants d'un candidat vaccin préventif
Un essai vaccinal de phase I avec un candidat vaccin (CD40.HIVRI.Env) a été lancé en février 2021 par une équipe française, coordonné par le Pr Yves Lévy. Ce vaccin repose sur une technologie innovante : l’utilisation d’anticorps monoclonaux conçus pour cibler spécifiquement des cellules du système immunitaire appelées "cellules dendritiques", le CD40. C’est la première fois qu’un vaccin cible directement ces cellules, dont le rôle est important dans l’activation du système immunitaire.
L'induction de la production d'anticorps anti-VIH était de 100 % dans les groupes traités en semaine 26. Le niveau d'anticorps produits est demeuré stable jusqu'en semaine 48. Des lymphocytes T CD4, dirigés contre la protéine d'enveloppe du VIH, ont été produits par les volontaires suite à l'injection.
Les résultats de cet essai montrent donc que le vaccin est sûr d'utilisation et qu'il est en capacité d'induire une réponse immunitaire humorale (celle qui produit des anticorps) et cellulaire rapide contre le VIH. La prochaine étape sera de proposer un essai de phase II pour déterminer la dose optimale et démontrer son efficacité.
Le résultat de ces travaux de recherche est paru dans la revue eClinical Medicine en octobre 2024.
Découverte d’un rajeunissement des lymphocytes T CD8+ après 20 ans de traitement de l’infection par le VIH
L’une des stratégies pour éradiquer le virus consiste à stimuler les réponses immunitaires. Une étude soutenue par l’ANRS MIE et menée par des équipes de l’Inserm, de l’université de Bordeaux et du CNRS (ImmunoConcEpT), a examiné l’évolution des lymphocytes T CD8+ après plusieurs décennies de traitement antirétroviral chez des personnes vivant avec le VIH. Les résultats montrent qu’il y a un renouvellement des cellules T CD8+, suggérant une capacité du système immunitaire à générer de nouvelles réponses.
Un nouveau patient en rémission
Un patient, suivi aux Hôpitaux universitaires de Genève, fait l’objet d’une étude en collaboration avec l’Institut Pasteur, l’Institut Cochin de l’Inserm et le consortium IciStem, suite à sa rémission vingt mois après une greffe de moelle osseuse.
Cette personne, traitée pour une tumeur myéloïde extra médullaire, a reçu une greffe de moelle osseuse en 2018. D'autres patients ont déjà été en rémission suite à une greffe de moelle osseuse pour un cancer. Cette fois-ci, la moelle osseuse n'était pas issue d'un donneur portant la mutation homozygote delta 32 du récepteur CCR5, qui protège contre l'infection du VIH.
Un mois après la greffe, le nombre des cellules du patient infectées par le VIH a diminué, ce qui a mené à l’arrêt progressif de son traitement antirétroviral. Cette étude prouve qu'il existe une possibilité de guérir du virus et offre de nouvelles perspectives thérapeutiques.
Des anticorps neutralisants à large spectre en lien avec le contrôle du virus
Des patients porteurs du VIH-1 ayant bénéficié d'un traitement antirétroviral précoce arrivent à contrôler le virus sur le long terme après l'arrêt de ce traitement. Ces personnes ont été identifiées grâce à l'étude VISCONTI. La rémission serait probablement liée à une présence d'anticorps neutralisant à large spectre chez les patients, dont l'anticorps EPTC112, qui cible la protéine.
La PrEP (prophylaxie pré-exposition), une solution hautement efficace
L’efficacité de la PrEP à la demande a été mise en évidence pour la première fois par l’essai ANRS IPERGAY en 2016 et a depuis été approuvée par l’OMS comme un outil de prévention efficace contre la transmission du VIH.
Les derniers résultats de l’étude ANRS "Prévenir" valident l’efficacité et la bonne tolérance en vie réelle de la prophylaxie pré-exposition (PrEP) à la demande, au bout de trois années de suivi.
Ces travaux sont dirigés par le Pr Jean-Michel Molina (professeur à l'Université de Paris et chef du service de maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Saint-Louis AP-HP) et menés en partenariat avec l'association AIDES.
Une incitation active au dépistage VIH : "Au Labo sans ordo"
Pour rendre le dépistage davantage accessible, les autorités sanitaires ont décidé de généraliser le dispositif "Au labo sans ordo" à l’ensemble du territoire depuis le 1er janvier 2022, qui permet d’inciter au dépistage en réalisant un test VIH sans prescription ni avance de frais dans tous les laboratoires de biologie. Le programme a été mené par l’Assurance Maladie, les ARS, les URPS de biologie, les collectivités territoriales et l’évaluation réalisée par trois équipes du CHU de Nice, de l’Inserm et de l’association Vers Paris sans SIDA, et soutenues par Santé publique France et l’ANRS | Maladies infectieuses émergentes.
Renforcer l’autonomie des populations à risque
Le projet ANRS-Makasi vise à renforcer l’autonomie en santé sexuelle des immigrés d’Afrique subsaharienne, à travers une intervention sur des lieux de passage (marchés, places, gares) pour proposer un dépistage VIH et hépatites. Des entretiens motivationnels personnalisés sont aussi proposés aux personnes immigrées et exposées à des risques, avec une orientation active vers les structures adaptées à leurs besoins. Ce projet a fait l’objet d’une phase pilote de neuf mois en 2018, puis de deux ans d’intervention par une équipe de recherche et les associations Afrique Avenir et ARCAT.
Mettre fin à la transmission du virus de la mère à l’enfant
Un groupe de chercheurs internationaux, mené par les Pr Philippe Van de Perre (Inserm, université de Montpellier, EFS et université des Antilles) et Ameena Goga (South Africain Medical Research Council – SA-MRC et université de Pretoria) préconise la mise en place d’un système de soins permettant d’identifier les causes locales de transmission du virus de la mère à l’enfant. Ils proposent également le recours à la PrEP pour les femmes enceintes ou allaitantes n’ayant pas le VIH.
Des essais cliniques sont en cours pour évaluer l’efficacité de la PrEP chez les nourrissons exposés, le recours à des anticorps neutralisants à large spectre ou le renforcement du traitement antirétroviral des mères vivant avec le VIH.
Alléger les traitements
S'il est possible de garder l'infection par le VIH sous contrôle, il est nécessaire pour cela de recevoir quotidiennement un traitement antirétroviral. L’essai ANRS-QUATUOR, qui a débuté en 2017, étudie une stratégie d’allègement thérapeutique chez plus de 600 patients infectés par le VIH-1. Cet essai révèle qu’une prise du traitement quatre jours sur sept est aussi efficace qu’une prise quotidienne.
Il est mené par le Dr Pierre de Truchis (service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Raymond-Poincaré AP-HP) et le Dr Roland Landman (Institut de médecine et d’épidémiologie appliquée, fondation Léon MBa, service de maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Bichat – Claude-Bernard AP-HP).