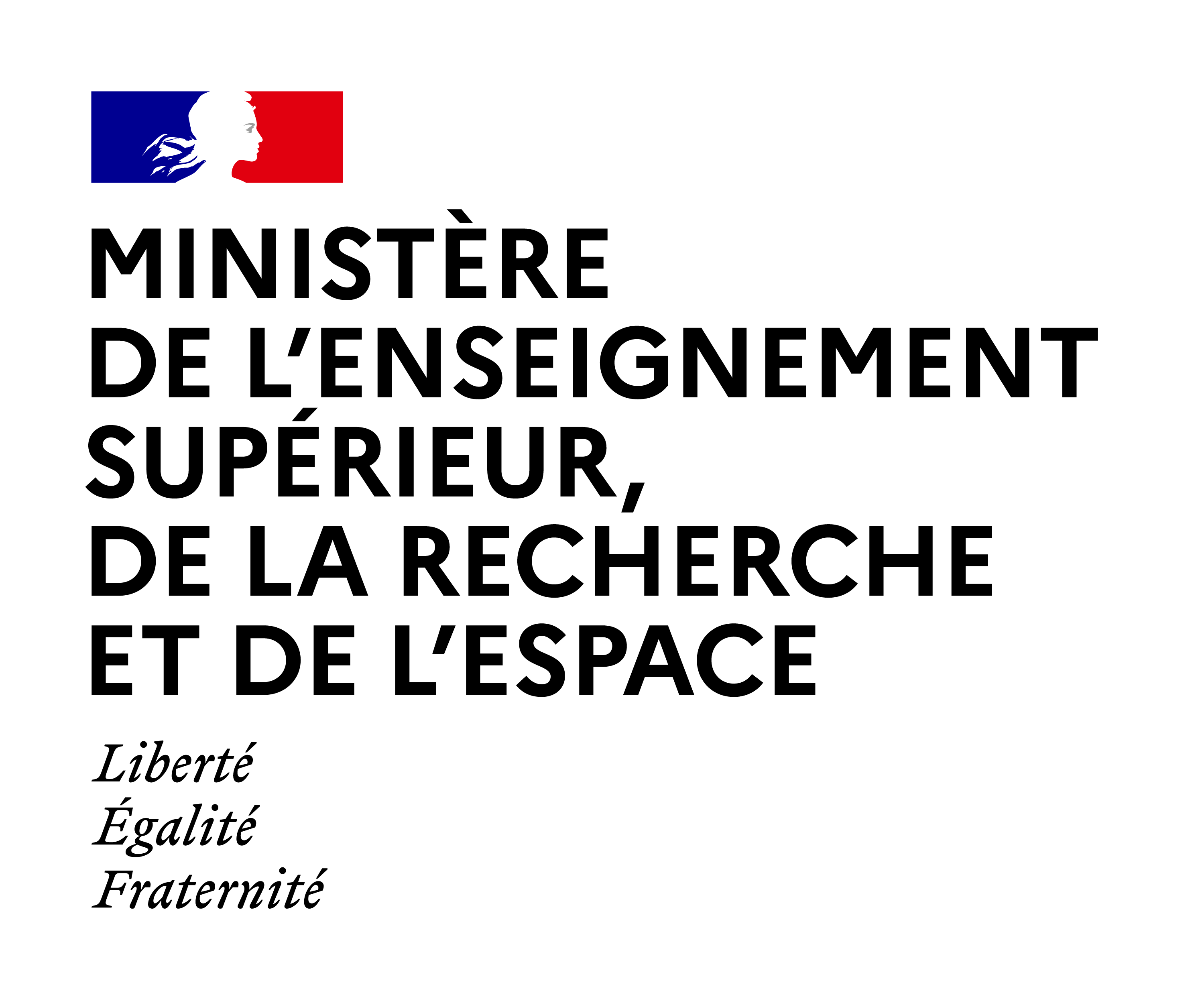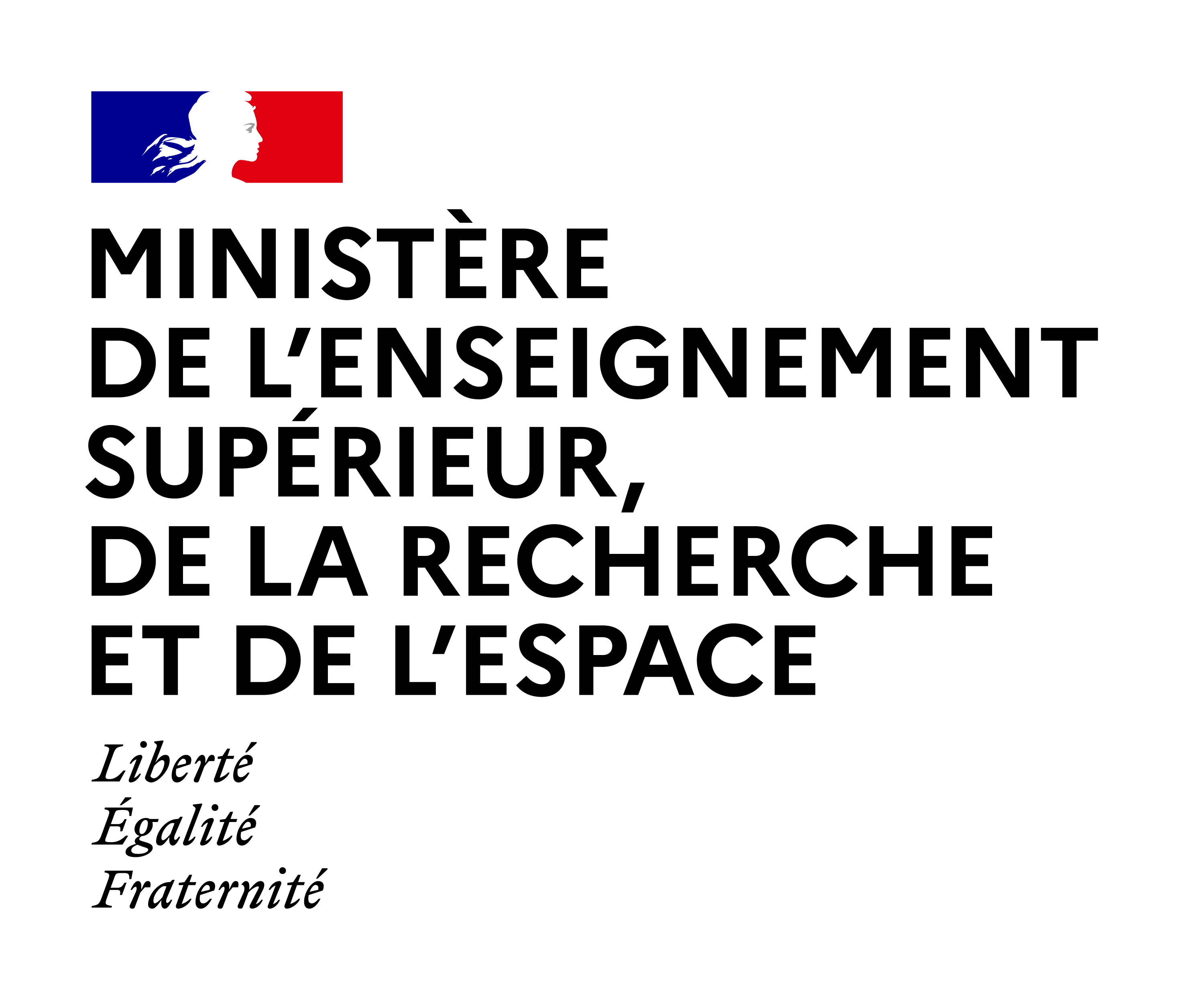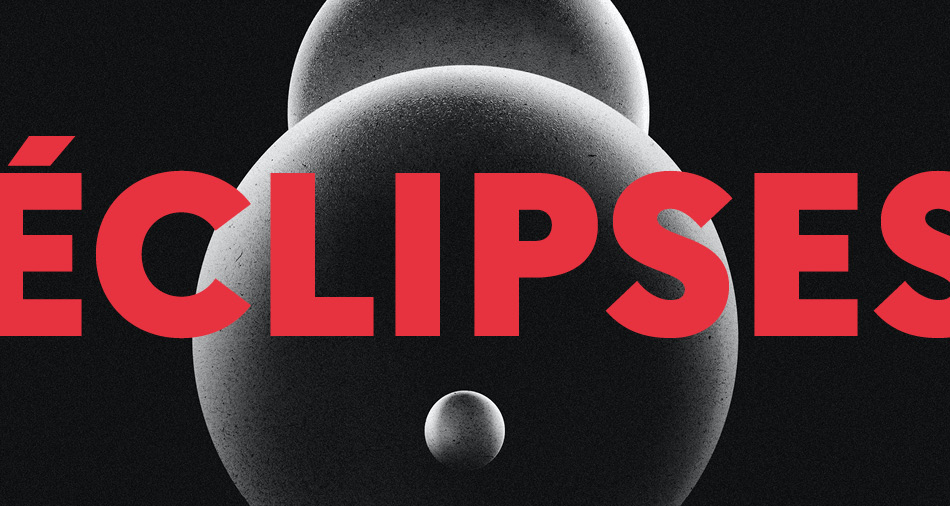Le mystère des éclipses dans l’histoire
Avant d’être des événements observés avec précision grâce à la science, les éclipses ont longtemps suscité crainte et incompréhension et étaient propices aux récits de l’étrange. Lorsqu’en plein jour le Soleil disparaissait soudainement derrière la Lune, ou que la Lune se teintait de rouge, les civilisations anciennes y voyaient souvent un signe funeste du destin. Dans la Chine antique, on pensait qu’un dragon dévorait l’astre solaire par exemple. Ces interprétations symboliques, traduisent la puissance de ces spectacles rares. Aujourd’hui, les éclipses ne relèvent plus du mystère ni de la superstition, mais s’expliquent entièrement par la mécanique céleste : l’alignement du Soleil, de la Terre et de la Lune.
Les éclipses sont sources d'émerveillement. Ce n’est pas pour rien que l'astronomie a sa muse, Uranie !
Comprendre la mécanique céleste des éclipses
L'étude des éclipses
Le travail des astronomes allie observation, calcul, modélisation et transmission du savoir. Les éclipses, bien qu’exceptionnelles, sont un moment privilégié pour ces chercheurs : elles offrent des conditions uniques pour observer par exemple la couronne solaire, cette fine couche extérieure de l’atmosphère du Soleil, visible uniquement lorsque le disque lumineux est occulté. Nous sommes allés à la rencontre de Florent Deleflie, chercheur au laboratoire Temps-Espace à l’Observatoire de Paris-PSL, pour en savoir plus sur les éclipses.
J'ai la chance d'exercer ce qu'on appelle un métier passion.
Zoom sur le phénomène
Les éclipses nous captivent, mais derrière se cache un phénomène rigoureusement géométrique. En effet, une éclipse se produit lorsque le Soleil, la Terre et la Lune s’alignent presque parfaitement dans un ordre bien précis.
Qu’est-ce qu’une éclipse ?
Une éclipse est un phénomène astronomique qui se produit lorsque trois astres s’alignent de manière à ce que l’un projette son ombre sur l’autre. Dès lors, la lumière du corps céleste (la Lune ou le Soleil) est occultée totalement ou en partie. Le phénomène se déroule sur quelques heures et l’astre éclipsé révèle la forme sphérique de la Terre et de la Lune.
Selon la position des trois astres, on observe deux types d’éclipses : l’éclipse de Soleil et l’éclipse de Lune.
Quelle est la différence entre une éclipse solaire et une éclipse lunaire ?
L’éclipse solaire a lieu quand les trois astres se retrouvent presque alignés dans l’ordre Soleil-Lune-Terre. La Lune passe entre la Terre et le Soleil, masquant totalement ou partiellement le disque solaire. L’éclipse dite de Soleil ne peut se produire qu’au moment de la Nouvelle Lune.
Pour une éclipse lunaire, les astres sont alignés dans l’ordre Soleil-Terre-Lune et elle se déroule uniquement lors de la pleine Lune. La Lune plonge alors dans l’ombre de notre planète et prend parfois cette couleur rougeâtre spectaculaire, qui lui vaut le surnom de « Lune de sang ».
Toutefois, pour qu’une éclipse se produise, les orbites doivent être parfaitement coplanaires, c'est-à-dire qu’il faut un alignement quasi-parfait dans les trois dimensions. En fonction de cet alignement, l’éclipse (solaire ou lunaire) sera soit partielle soit totale. Une éclipse totale est un phénomène bien plus rare qu’une éclipse partielle, car elle nécessite un alignement quasi-parfait entre les trois astres. Ces événements se produisent une à deux fois par an, et il n’est pas exceptionnel qu’une éclipse de Lune survienne environ quinze jours après une éclipse de Soleil. En revanche, les éclipses totales de Soleil observables depuis un même lieu sont extrêmement rares : la zone où le Soleil est entièrement occulté, appelée bande de centralité, ne représente qu’environ 2 % de la surface terrestre.
C’est cette rareté qui pousse de nombreux passionnés (astronomes, amateurs ou simples curieux) à parcourir le monde pour assister à ce spectacle fugace. La différence entre une éclipse totale et une éclipse partielle est saisissante : lors d’une éclipse totale, le jour bascule dans la nuit et la couronne solaire devient visible, tandis que dans une éclipse partielle, seul un fragment du disque solaire disparaît derrière la Lune.
Comment observer les éclipses ?
Si vous êtes prêts à devenir un véritable « chasseurs d’éclipses », vous pouvez connaître les prochaines dates des éclipses et les conditions d’observation depuis le lieu propice sur Terre, grâce au formulaire de calcul du Service Espace de l'Observatoire de Paris .
Rencontre avec Florent Deleflie
Pouvez-vous vous présenter ?
Florent Deleflie : Je suis chercheur au Laboratoire Temps-Espace, anciennement IMCCE, de l’Observatoire de Paris-PSL. J’essaie de faire découvrir à tous les types de publics les différentes facettes de cette fascinante science qu’est l’astronomie, la première des sciences peut-être, et que l’on peut aborder de bien des manières : l’observation, les calculs, l’histoire, les différentes cultures du monde.
En quoi consiste le travail d’un astronome ? Quel est votre rôle lorsqu’une éclipse se produit ?
F. D : Mes domaines de recherche portent sur l’étude des trajectoires des satellites artificiels autour de la Terre. En tant que membre du Corps National des Astronomes et Physiciens, je consacre mon temps, non seulement à la recherche mais aussi à des tâches d’enseignement, de service à la communauté scientifique. Je consacre aussi une part importante à ce qui s’appelle la diffusion de la culture scientifique, pour rendre la Science à travers ma discipline accessible à un maximum de personnes ! Quand une éclipse se produit, certains de mes collègues en profitent pour mener des expériences d’astrophysique sur l’étude de la couronne solaire par exemple. De mon côté, je m’intéresse avant tout à l’étude des trajectoires donc aux aspects mathématiques du calcul d’éclipse. Je tâche d'expliquer le phénomène, de le démystifier tout en insistant sur l’émerveillement que peut procurer l’un des plus beaux phénomènes de la nature, que les lois de la mécanique céleste permettent de prévoir à l’avance.
Pourquoi avoir choisi ce métier ? Qu’est-ce qui vous fascine le plus dans votre métier ?
F. D : Depuis tout petit j’observe le ciel, qui me fascine, et je pratique l’astronomie dans une approche multidisciplinaire. Faire de l’astronomie, c'est appréhender à travers la science, toutes les questions de la relation de l'homme à son environnement, la terre et le ciel évidemment qui nous dépasse. Devenir astronome avait été un rêve depuis tout petit, une manière aussi de mettre en application les lois des mathématiques que j'avais apprises étant à l’université. Aujourd'hui, j'ai la chance d'exercer ce qu'on appelle un métier passion.
Quels types d’outils/technologies utilisez-vous aujourd’hui pour observer ces phénomènes ?
F. D : Tout dépend du type d’étude que l’on souhaite mener lors d’une éclipse. Les astrophysiciens disposent aujourd’hui d’instruments sophistiqués, notamment des spectrographes permettant de décomposer la lumière pour analyser la composition et la dynamique de la couronne solaire. Pour le mécanicien céleste ou l’astronome amateur, le simple fait de voir l’éclipse se dérouler exactement comme prévu par les calculs constitue déjà une grande source de satisfaction. Aucune précaution particulière n’est nécessaire pour observer une éclipse de Lune. En revanche, pour une éclipse de Soleil, il est impératif de protéger ses yeux : regarder le Soleil sans filtre adapté peut provoquer des brûlures irréversibles de la rétine. Ce conseil vaut d’ailleurs tous les jours, car le Soleil n’est pas plus dangereux lors d’une éclipse que le reste du temps.
Il faut donc utiliser du matériel spécifiquement conçu à cet effet, facilement disponible dans les laboratoires ou auprès des associations d’astronomes amateurs.
Quels types de données peut-on recueillir pendant une éclipse ? Que peut-on étudier avec les résultats obtenus ?
F. D : Les éclipses de Soleil offrent encore aujourd’hui un intérêt scientifique, notamment pour l’étude de la couronne solaire, cette région externe du Soleil habituellement masquée par son éclat intense. Les observations réalisées pendant une éclipse permettent d’analyser sa structure, sa dynamique et ses variations, en complément des données recueillies par les satellites d’observation solaire. En revanche, pour le mécanicien céleste, les éclipses n’ont plus le même intérêt qu’autrefois : les théories du mouvement des astres sont désormais d’une précision remarquable. L’éclipse reste donc avant tout un moment privilégié d’émerveillement et de partage entre science, beauté du ciel et curiosité humaine.
Quelle est la meilleure manière pour le public d’observer une éclipse ?
F. D : Les éclipses sont sources d'émerveillement. La bonne réponse c'est : en groupe ou en famille pour partager les émotions, suscitées par le phénomène qui n'est pas qu'un simple phénomène astronomique mais qui va avoir une influence sur l'environnement dans lequel on l'observe : variation de température,variation de lumière, modification du comportement des animaux, etc.
Y a-t-il des mythes ou des idées reçues que vous aimeriez déconstruire à propos des éclipses ?
F. D : La première idée qu’il faut encore déconstruire, c’est celle selon laquelle il serait plus dangereux d’observer le Soleil lors d’une éclipse qu’à n’importe quel autre moment. En réalité, le risque est exactement le même : il suffit d’utiliser les protections adaptées, comme toujours. Une éclipse n’est rien d’autre qu’un alignement remarquable de trois astres aux mouvements parfaitement connus. Ces phénomènes, que nous comprenons désormais en détail, ne devraient susciter qu’émerveillement et curiosité. Aujourd’hui, grâce aux technologies modernes, chacun peut en garder la trace à travers des photos, des dessins ou des créations artistiques inspirées par ce spectacle céleste rare.