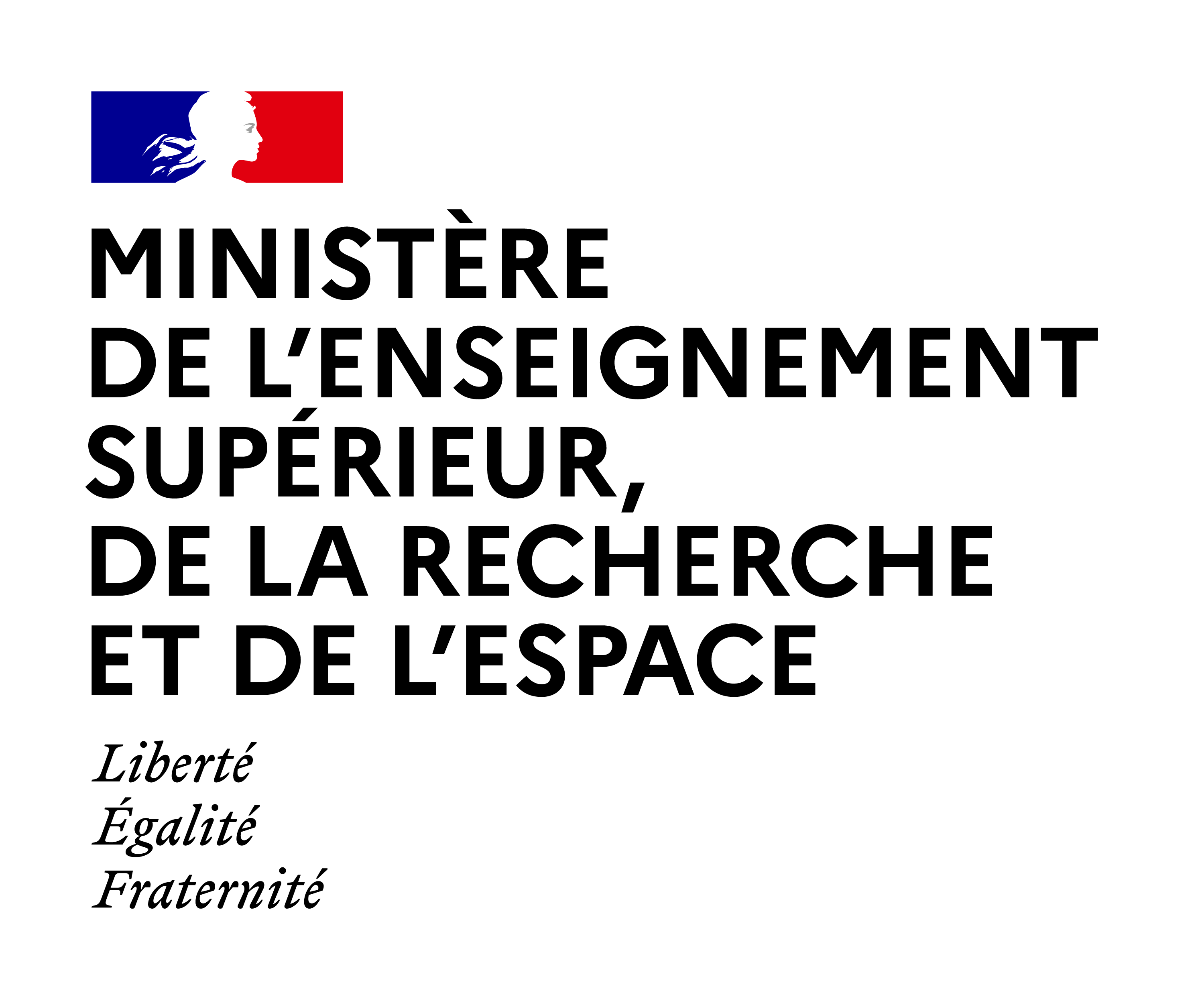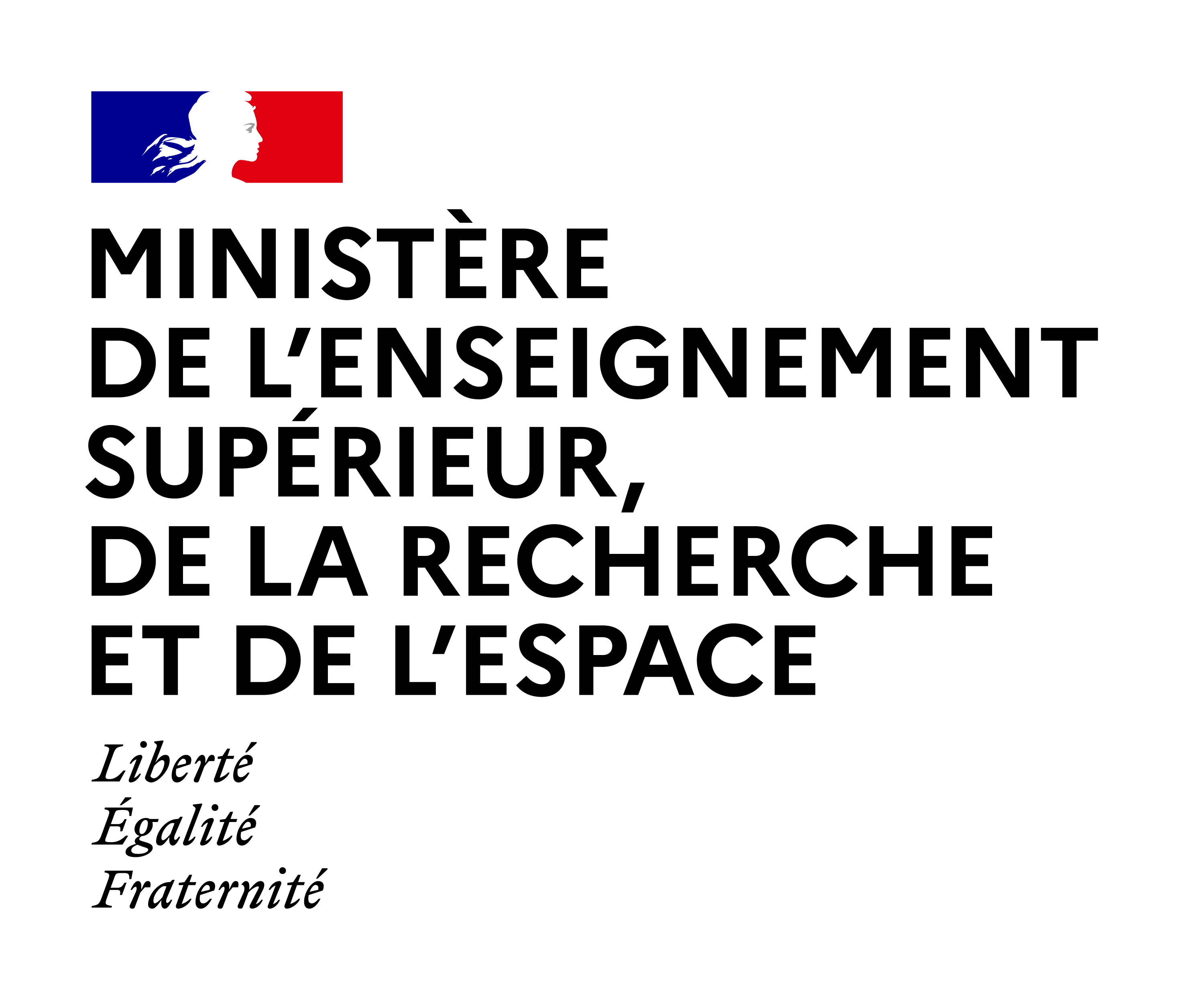Pour aider les établissements d’enseignement supérieur à mieux accompagner, reconnaître et valoriser ces parcours, la Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (DGESIP) publie un recueil de recommandations et de bonnes pratiques.
Objectif : proposer un cadre clair et opérationnel, nourri d'exemples concrets, pour déployer localement une politique de reconnaissance et valorisation de l'engagement étudiant.
Pourquoi valoriser l'engagement étudiant ?
Un axe fort des politiques publiques depuis 2017
La loi relative à l’égalité et à la citoyenneté (27 janvier 2017) a ouvert la voie. Depuis, plusieurs mesures ont contribué ou renforcé le cadre d’action : la création de la CVEC (contribution vie étudiante et de campus), la stratégie européenne en faveur de la jeunesse (2019–2027), et plus récemment la circulaire du 23 mars 2022, qui a précisé les modalités de validation et de valorisation des compétences issues de l’engagement.
Des bénéfices à tous les niveaux
Côté étudiants, l’engagement contribue à son épanouissement personnel et à son bien-être et permet de développer des compétences clés : prise d’initiative, communication, travail en équipe, adaptabilité… Des atouts précieux pour la réussite personnelle et académique comme pour l’insertion professionnelle. Il contribue aussi à forger une identité citoyenne et un sentiment d’appartenance.
Côté établissements, reconnaître et valoriser l’engagement étudiant permet de faire vivre des valeurs, de renforcer l’attractivité et d’affirmer une mission sociale.
Et pour la société dans son ensemble, l’engagement est un vecteur de cohésion et d’énergie collective. Il contribue également au dynamisme territorial.
Un recueil conçu avec les acteurs de terrain
Une construction collective
Ce recueil n’est pas le fruit d’un travail en chambre. Il a été élaboré avec les principales conférences d’établissements (France Universités, CGE, CDEFI, CDEFM), les réseaux de vice-présidents CFVU, VECU, les responsables de vie étudiante, les directions des études et de la scolarité, d’orientations et d’insertion professionnelle… Les étudiants eux-mêmes y ont été associés via leurs organisations représentatives (CEVPU, BNEI, BNEM). Les collectivités territoriales, les ministères concernés et plusieurs associations partenaires ont également pris part aux échanges.
Une approche interministérielle
Porté par la DGESIP, ce projet s’inscrit dans une dynamique plus large, en lien avec la Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA). L’objectif : favoriser l’engagement tout au long de la vie, en facilitant l’articulation entre parcours académiques, implication citoyenne et reconnaissance institutionnelle.
Adopter une approche locale pour mettre en œuvre cette valorisation
Il n'y a pas de modèle unique. Chaque établissement est invité à définir ce qu’il entend par « engagement étudiant » – en fonction de sa culture, de ses priorités et de ses ressources – à définir comment il le reconnait et le valorise - en s’inscrivant dans le cadre légal- et à l’inscrire dans ses textes de référence : schéma directeur de la vie étudiante, contrat d’objectifs, de moyens et de performance, règlement des études…
Les étudiants engagés doivent être reconnus comme un public à part entière, pouvant bénéficier d’aménagements spécifiques.
Le recueil propose plusieurs options de reconnaissance, adaptables selon les contextes, par exemple :
- Unités d’enseignement (UE) libres ou optionnelles
- Crédits ECTS liés à l’engagement
- Dispenses d’enseignements ou de stages
- Bonus pris en compte par les jurys
- Diplômes universitaires (DU) valorisant un parcours d’engagement
Valoriser les compétences acquises et accompagner les étudiants engagés
Valoriser, c'est aussi rendre lisibles les acquis pour les acteurs de la formation, le monde socio-économique… mais aussi pour les étudiants eux-mêmes. Cette conscientisation par les étudiants des compétences acquises lors de leur engagement est essentielle pour pouvoir ensuite la valoriser lors de leur parcours académique ou professionnel. Pour cela, des outils comme les portfolios institutionnels ou les open badges permettent de formaliser les compétences développées et de les transférer vers d’autres sphères (emploi, formation, bénévolat…).
L’efficacité passe aussi par un accompagnement pédagogique et administratif : référents identifiés, modules de formation, appui aux encadrants… Chaque maillon compte pour assurer cohérence et continuité.
Des exemples inspirants de dispositifs de reconnaissance et de valorisation de l’engagement étudiant et de référentiels de compétences sont proposés dans le recueil afin de pouvoir essaimer ces bonnes pratiques le plus largement possible.
Chacun de ces dispositifs illustre une mise en œuvre pragmatique et contextualisée, à adapter selon les priorités et les moyens de l’établissement.
Quelques éléments d’attention
Préserver l’équilibre entre études et engagement
La conciliation entre parcours académique et implication personnelle demande une gestion fine du temps. Des aménagements (dispenses, allègements, souplesse dans les horaires) sont nécessaires pour ne pas pénaliser les étudiants.
Veiller à l’égalité des chances
Les établissements doivent veiller à l’égalité entre étudiants, notamment en facilitant les parcours des étudiants issus de milieux plus dévalorisés, les étudiants salariés ou encore à besoins spécifiques
Vérifier la qualité des structures d’accueil
L’engagement étudiant ne doit pas masquer une activité salariée. Pour éviter tout risque de salariat déguisé, il est recommandé de vérifier de la viabilité de la structure d’accueil. A cet égard, s’appuyer sur des plateformes reconnues comme JeVeuxAider.gouv.fr ou API Engagement ou encore des associations nationales type Animafac ou Afev peut être utiles
Pour conclure, l’engagement étudiant à la croisée des dimensions formation et vie étudiante et pour un meilleur ancrage territorial
Ainsi, Dans le cursus d’enseignement supérieur, l’engagement étudiant trouve sa place tant dans les dimensions de formations que de vie étudiante. Il met en évidence la nécessité de développer un ensemble de compétences à la fois disciplinaires et transversales, incluant les savoirs académiques, les soft skills, et les compétences psychosociales, indispensables dans une société en perpétuel changement.
Il permet aussi de revoir la manière d’enseigner dans une approche de service learning, au service de la société, des enjeux de développement durables et de responsabilités sociales et sociétales, et des territoires.
Cette approche favorise l’intégration des campus au sein des territoires.