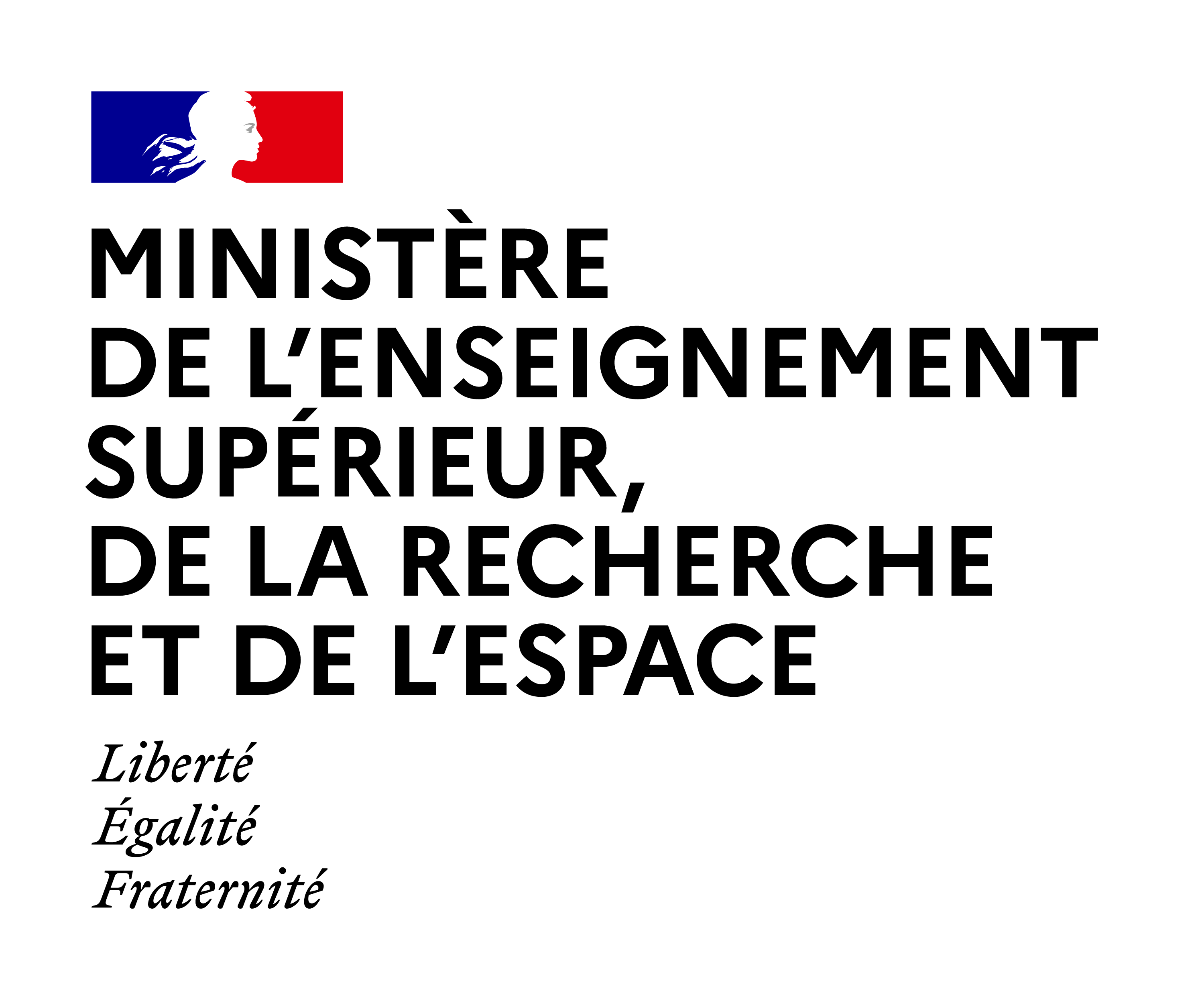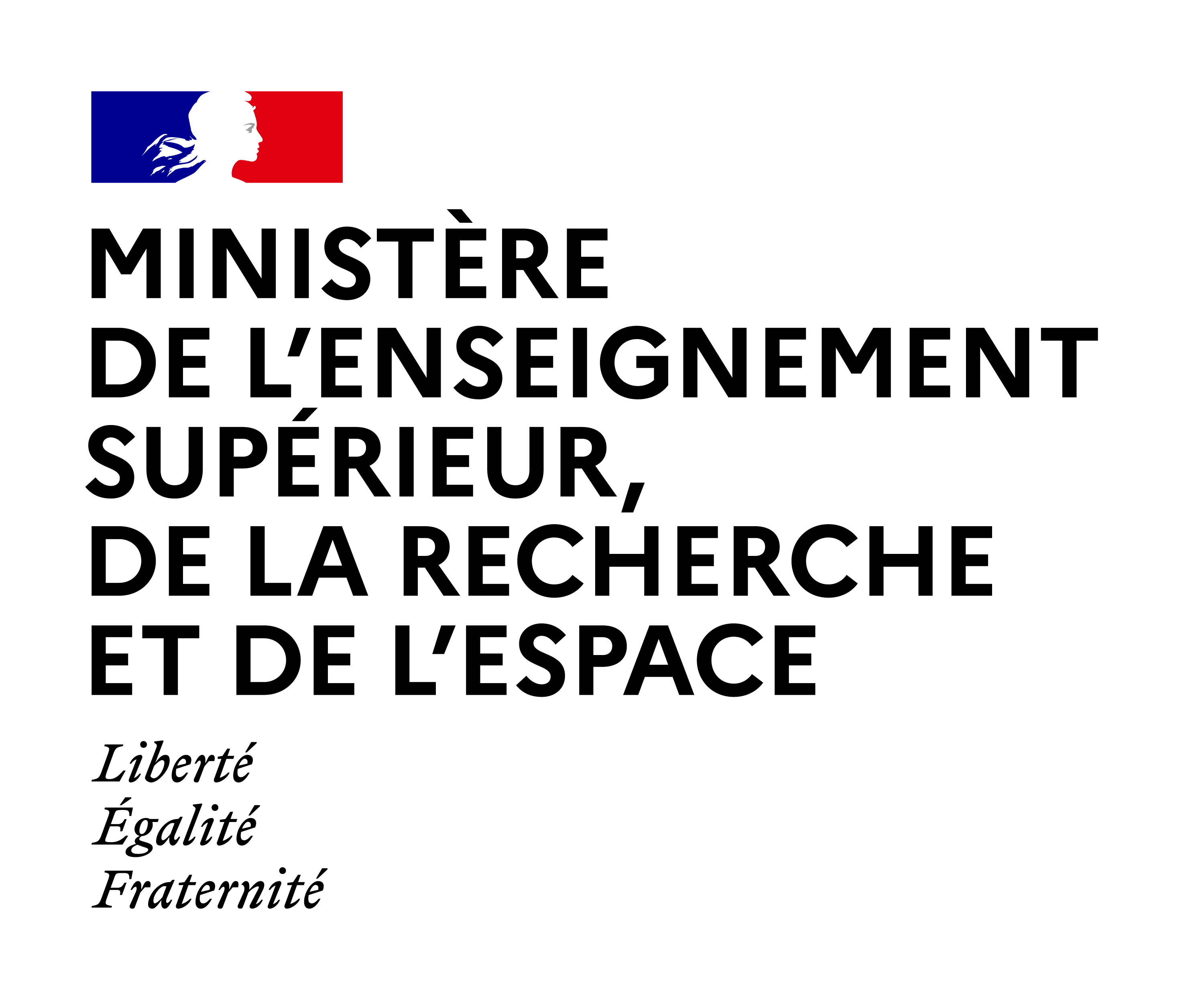Le festival de l'histoire de l'art favorise le partage des connaissances et interroge les avancées technologiques, nouvelles méthodes de recherche. Nous sommes allés à la rencontre de chercheurs et chercheuses qui prennent en compte l'intégration des évolutions technologiques dans le cadre de projets de recherche innovants.
Clara Bernard, conservatrice : changer de regard
Clara Bernard est conservatrice du patrimoine à l’Institut national d’histoire de l’art (INHA). Dans le cadre de la 14e édition du Festival de l'histoire de l'art, elle participait à deux tables-rondes, l'une à propos de la datavisualisation du programme de recherche de l’INHA, « Répertoire des ventes d’antiques », la seconde, ayant pour sujet : fabrication, circulation et exposition des faux antiques au XIXe siècle. Elle évoque les évolutions technologiques liées à la datavisualisation et ses bénéfices pour les travaux de recherche. Nous l'avons également interrogée à propos du thème du festival, « le vrai, le faux », qui l'amène à évoquer le rapport contemporain à l'authenticité des œuvres.
« Avant de s'interroger sur la présence des faux, il faut peut-être s'interroger sur ce qu'est un faux et notre regard contemporain est beaucoup plus critique et peut-être biaisé en partie. (...) Aujourd'hui, on se rend compte que la frontière entre la restauration, le pastiche, la falsification et la création de faux, peut être très ténue. En réalité, il est intéressant d'interroger cette frontière et essayer de se défaire de notre regard contemporain. » Clara Bernard, conservatrice du patrimoine à l'INHA.
Yannick Vandenberghe, ingénieur d’études : faire parler la matérialité des œuvres
Yannick Vandenberghe est spécialiste de la polychromie des œuvres antiques. Ingénieur d’études au Centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF), dans une approche matérielle, il fait parler les œuvres grâce à des méthodes d'analyse complémentaires à celles d'un conservateur ou d'un historien. Un travail pluridisciplinaire qui permet d'attester de l'authenticité des œuvres, ce dont il nous a parlé à l'occasion de la 14e édition du Festival de l'histoire de l'art qui avait pour thème, le vrai et le faux.
« L’étude de la matérialité, au-delà de l’attestation d’authenticité, peut fournir des informations précieuses qui renforcent la valeur d'une œuvre. Cet aspect entre parfois en ligne de compte dans le cadre des nouvelles acquisitions. C’est le cas d’une figurine en terre cuite grecque, entrée récemment dans les collections du département des antiquités grecques, étrusques et romaines du musée du Louvre. Il s’agit d’une femme drapée presque identique à la célèbre Dame en bleu, également conservée au musée. En complément de l’étude stylistique et technique (...), une étude matérielle de la polychromie a été menée par le C2RMF afin de confirmer l’hypothèse que ces deux figurines proviennent d’une même tombe. Pour cela, un dossier d’imagerie scientifique complet, et un ensemble d’analyses physico-chimiques par des techniques élémentaires et structurales non invasives, ainsi que l’étude de quelques micro-prélèvements. Les données collectées permettent d’être sans conteste affirmatifs quant à la provenance commune de ces deux figurines et leur attribution à un même atelier, voire très probablement à un même artisan. C’est d’ailleurs la toute première fois qu’il a été possible de réaliser l’attribution de figurines à un peintre ayant été actif à Tanagra vers 330 av. J.-C. » Yannick Vandenberghe, ingénieur d’études au C2RMF