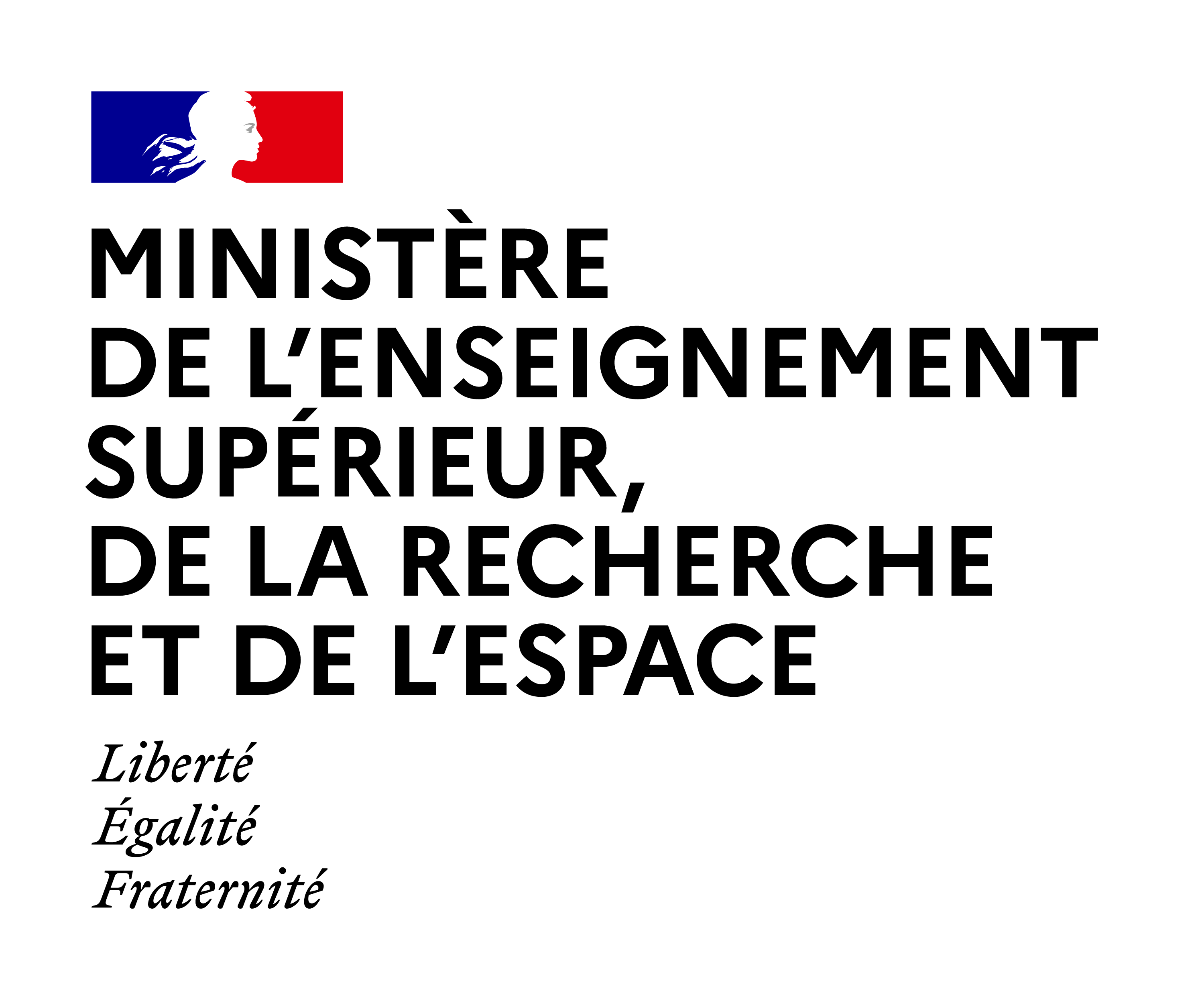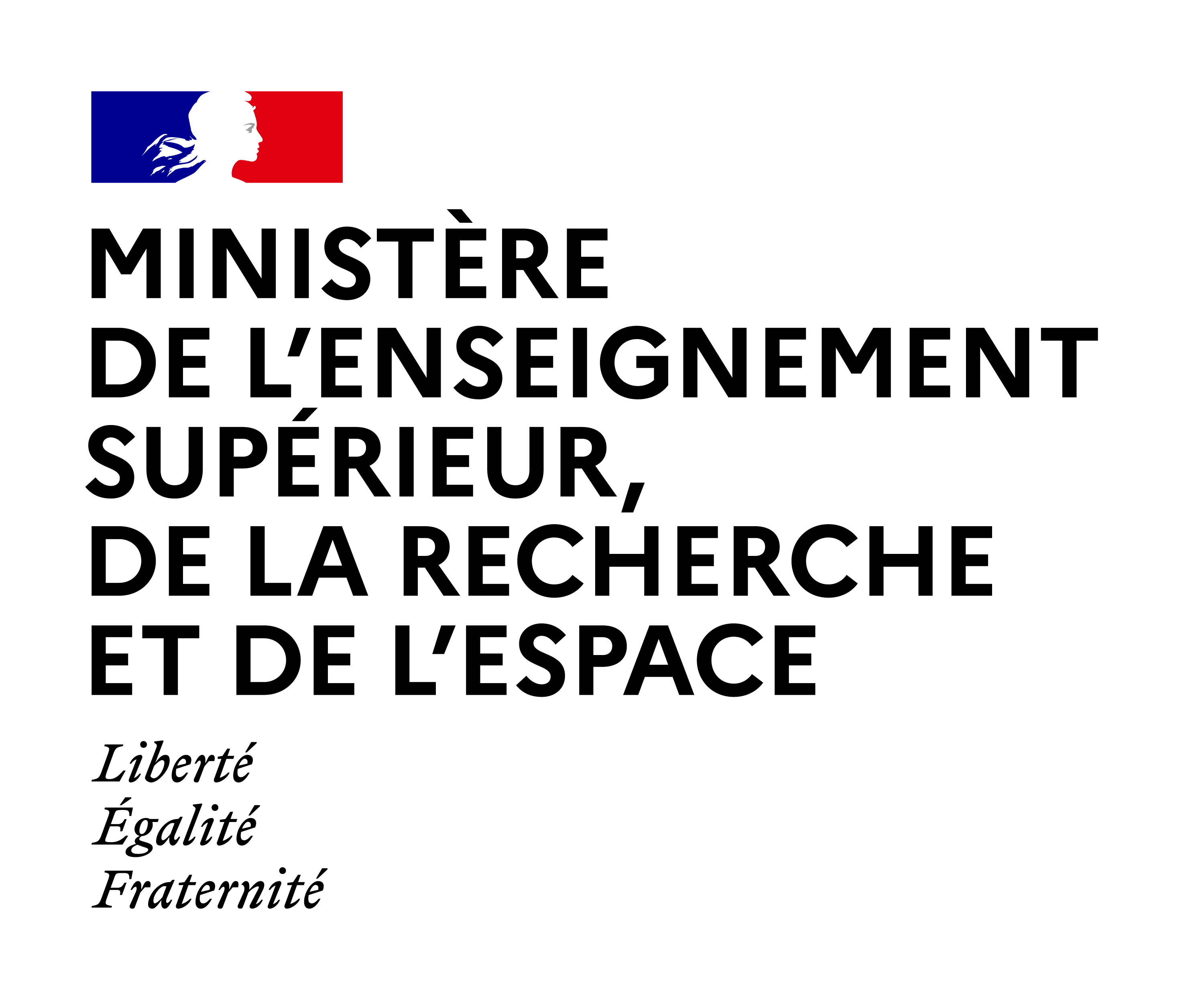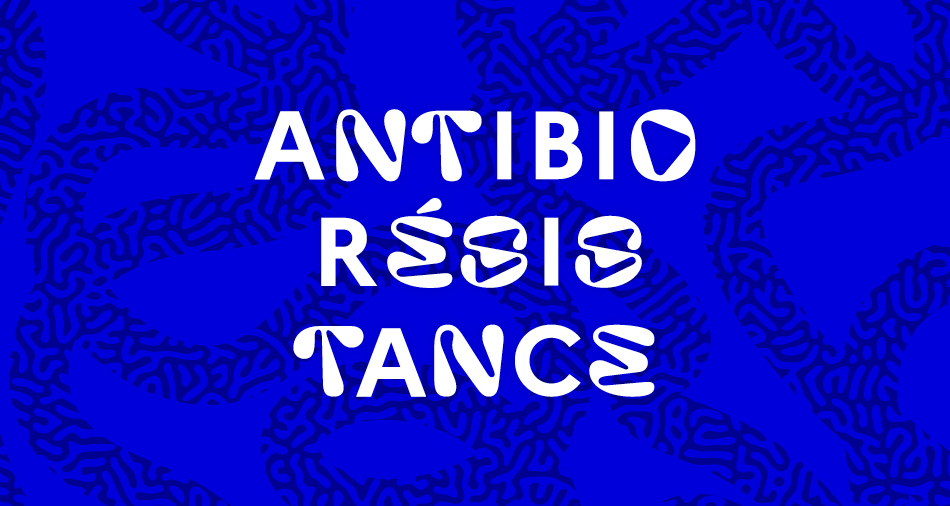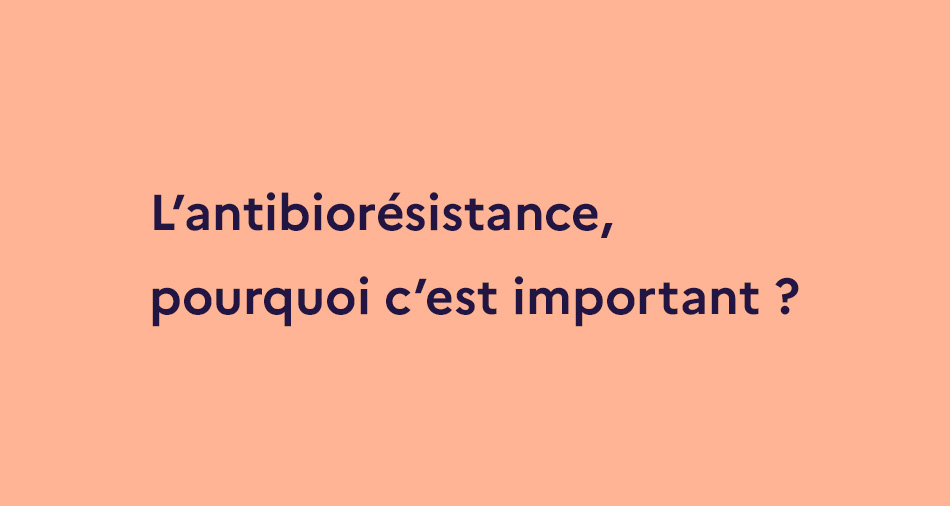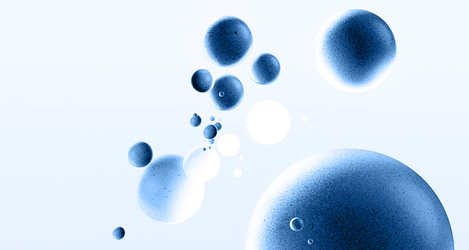Qu'est-ce que l'antibiorésistance ?
Découverts dans les années 1940, les antibiotiques sont des molécules capables de limiter la croissance des bactéries ou de les tuer.
L'administration répétée d'antibiotiques chez l'homme ou l'animal favorise l'émergence de souches de bactéries résistantes aux antibiotiques. On parle alors d'antibiorésistance. Celle-ci concerne aujourd’hui l’ensemble des bactéries pathogènes et touche tous les domaines de la médecine liés au risque infectieux (chirurgie, oncohématologie, transplantation d’organes...).
L'antibiorésistance, pourquoi est-ce important ?
Vidéo : les explications de Grégory Emery, directeur général de la santé
En 2025, l’Organisation Mondiale de la Santé a souligné, pour la première fois, la prévalence de la résistance à 22 antibiotiques utilisés pour traiter les infections des voies urinaires et gastro-intestinales et sanguines, et la gonorrhée.
Aujourd’hui, les nouvelles molécules sont rares ; en conséquence, il est difficile, voire impossible de traiter certaines infections. À noter que les gestes barrières et la vaccination demeurent très efficaces pour se prémunir des infections virales contre lesquelles les antibiotiques sont inefficaces.
En réponse à cette problématique, "One Health" ou "une seule santé" est une approche intégrée qui reconnaît les liens étroits entre la santé humaine, animale et celle des écosystèmes, et aborde les défis de santé publique de manière collaborative et pluridisciplinaire.
Programme prioritaire de recherche (PPR) Antibiorésistance
En réponse à la problématique de résistance aux antibiotiques, un Programme prioritaire de recherche (PPR) Antibiorésistance a été créé en 2021. Ce programme national antibiorésistance est financé à hauteur de 40 millions d’euros sur 10 ans. Il a pour objectifs de :
- mettre en œuvre un programme de recherche français ambitieux ;
- proposer de nouvelles stratégies en santé publique et mesures de lutte dans le but de réduire et d’optimiser l’usage des antibiotiques, en médecine humaine et vétérinaire, et cela, afin d’inverser la courbe des résistances.
Le pilotage scientifique et l’animation de ce programme sont confiés à l’Inserm. L’Agence nationale de la recherche (ANR) en est l’opérateur.
Entre 2021 et 2022, 11 projets ont été retenus à l'issue de l'appel à manifestation d'intérêt « comprendre, innover, agir », avec la création de 8 chaires junior et d'une chaire senior, la mise en place de 3 projets structurants nationaux et le soutien de 2 projets avec les pays à ressources limitées. C'est donc un total de 22 projets financés qui sont à découvrir sur l’interface nationale Antibiorésistance.
Evelyne Jouvin-Marche, directrice scientifique du PPR Antibiorésistance, directrice de recherche INSERM
Selon vous, pourquoi est-il crucial de continuer à mettre en lumière cette semaine mondiale de sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens ?
Evelyne Jouvin-Marche : Au niveau mondial, les progrès en médecine avancent moins vite que ne progresse l’antibiorésistance.
La particularité de la lutte contre la résistance aux antibiotiques est qu’elle nécessite une réponse multisectorielle incluant santé humaine, animale, environnementale et socio-économique. Elle doit être accompagnée par le renforcement simultané de la recherche, de la prévention et des politiques publiques, mais aussi de journées dédiées pour communiquer et diffuser les informations et les menaces sur la multiplication des résistances.
Il est intéressant de noter le paradoxe français d’une très grande consommation d’antibiotiques avec une présence dans le classement des pays présentant le moins de résistances aux antibiotiques en raison de son réseau de surveillance.
Les mécanismes de cette résistance ne sont pas encore tous décrits.
Depuis son lancement en 2020, quelles ont été les avancées majeures du PPR Antibiorésistance ?
Evelyne Jouvin-Marche : Avec plus de 300 publications référencées dans Web Of Science, le PPR Antibiorésistance a largement contribué à l’avancée des recherches autour de :
1. Recherche et innovation, notamment :
- Approche One Health – en appui de technologies innovantes (biologie de synthèse, microfluidique, intelligence artificielle, épigénétique)
- Meilleure compréhension de la dynamique de la résistance aux antibiotiques au niveau de l’intestin humain et dans les interactions entre les bactéries
- Caractérisation des communautés bactériennes du sol, de nouveaux composés/molécules antimicrobiens présentant des activités spécifiques et prometteuses
- Détermination et impact de la présence de bactéries/gènes de résistance dans l’environnement
- Caractérisation des réseaux de transmission de la résistance aux antimicrobiens dans et entre les écosystèmes des trois santés (humaine, animale, environnementale)
- Nouvelles approches dans l'exploration de données omiques et modélisation
- Nouvelles stratégies contre la résistance aux antibiotiques de la tuberculose
- etc.
2. Prévention, surveillance et santé publique, entre autres :
- Développement d'outils et cadrage des déterminants contextuels professionnels et organisationnels de l'utilisation des antibiotiques visant à améliorer le bon usage des antibiotiques
- Modélisation des parcours des patients et la surveillance des eaux usées
- Développement d’un entrepôt de données de surveillance rassemblant les résistances des 3 écosystèmes (humain, animal, environnement)
- etc.
3. Structuration et développement :
- Développement de nouvelles bibliothèques chimiques
- Création de la plateforme publique française dédiée à la phagothérapie
- Ouverture de ABRomics, première plateforme numérique regroupant l’ensemble des résistances de 2 écosystèmes (humain et animal).
Quelles sont les prochaines actions prévues par le PPR Antibiorésistance ?
Evelyne Jouvin-Marche : Le PPR Antibiorésistance prévoit un renforcement de 1 M€ des plateformes structurantes : ABROmics, Promise et DOSA. Le programme va également lancer 2 nouveaux appels :
- Un appel à projets de 2 M€ géré par l’ANR
- Un appel à chaires juniors de 1,5M€ pour le financement de 3 chaires.