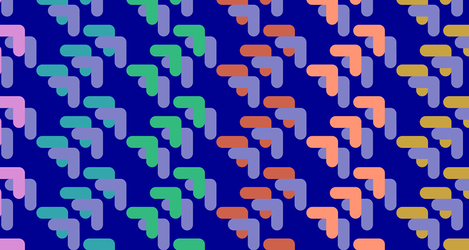Guide de la vie étudiante à destination des lycéens - 2025
Document destiné aux lycéens qui s'apprêtent à entrer dans l'enseignement supérieur, souhaitent connaître leurs droits et s'informer sur les démarches.
Déclarée « Grande cause nationale » en 2025, la santé mentale est un sujet majeur pour le ministère : accompagnement psychologique des étudiants, financement d'une recherche de pointe en psychiatrie, soutien de nombreuses initiatives...